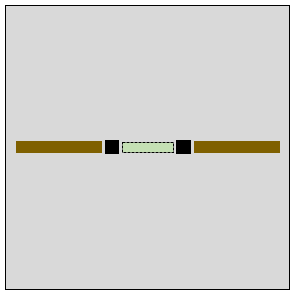Rappelons qu'on distingue schématiquement trois grandes familles de croix du point de vue de leur structure (plus précisément ici leur pied ou fût) :
- des croix à structure tridimensionnelle (3D, volumiques)
comportant quatre fers structurels montants (FF3D) ;
- des croix à structure bidimensionnelle (2D, planes ou surfaciques) comportant deux fers structurels montants (FF2D) ;
- des croix à structure unidimensionnelle (1D) comportant un fer structurel montant unique (FF1D).
Pour plus de détails, consulter la page dédiée à la typologie
des structures des groupes de croix.
Les consoles assurent une fonction
mécanique ou structurelle
Les consoles, comme l'étymologie de leur nom le laisse entendre
(“Console : mot peut-être abrégé de consolider”, Littré)
ont essentiellement, et à l'origine, une fonction mécanique ou
structurelle : il s'agit de consolider la croix. Celle-ci étant
un petit monument élancé, dressé vers le Ciel (à la manière d'un
arbre), elle présente une réelle fragilité, avec un risque non
négligeable de renversement face à des efforts transversaux
(vent, intempéries, maladresses humaines ou animales...).
À l'origine, les anciennes croix en pierre à fût-colonne plein
pouvaient assez aisément résister par leur masse à ces efforts
transversaux. Il n'en n'est, par contre, pas de même pour les
croix métalliques qui les ont remplacées. Les fers structurels
montants de ces croix métalliques sont scellés dans la pierre de
la corniche du piédestal et restent plutôt frêles. Même si leur
prise au vent est plus réduite que celle des croix en pierre,
les croix métalliques nécessitent donc des renforcements
structurels, avec des fers d'entretoisement placés ici ou là et
surtout un dispositif de consolidation-soutien en pied. Outre le
fait que les croix en fer peuvent être renversées, leurs longs
fers structurels (en barres de fer laminé) peuvent aussi se
tordre, se vriller, causant alors des dégâts importants dans la
partie supérieure des croix.
Les consoles viennent donc maintenir la croix en partie basse de
celle-ci. Elles la stabilisent et contribuent également à la
résistance du monument au vrillage. Cette fonction purement
mécanique sera en général assurée par quatre consoles placées le
plus souvent sur les diagonales du piédestal (pour une meilleure
assise) ou plus rarement selon les axes principaux du monument.
On trouve également des cas d'étaiement de la croix par deux
consoles seulement (placées latéralement) et parfois (plus
rarement) par un jeu de six consoles.
Ces consoles de soutien ont été réalisées à partir de fers
forgés de section carrée ou en fer plat. Elles s'élevent en
biais, des bords de la corniche en bas vers le centre de la
structure en haut. Elles s'appuient d'une part, en partie basse,
sur la pierre de corniche (scellement, colliers d'accroches...)
et d'autre part, en partie haute, sur les fers structurels
montants (boulonnage, vissage, recours à des colliers...).
Les consoles et leur fonction esthétique
ou décorative
Très vite, ces consoles ont adopté des formes de plus en plus
complexes (en S) intégrant des volutes ou rouleaux en fer forgé.
Ainsi, à la fonction purement mécanique ou structurelle des
consoles est venue s'ajouter une fonction esthétique ou
décorative, avec complexification de la forme des consoles et
parfois ajout de nombreux petits motifs en fer forgé : fleurs
d'eau en fer étampé, fleurettes, pointes, flammes.... Placées en
partie basse de la croix, ces consoles sont très visibles et
témoignent de la volonté de leur concepteur d'offrir du plaisir
visuel.
Une schématisation pour comprendre ces
dispositifs de soutien par consoles
Pour décrire les différentes types ou solutions de soutien
structurel (consoles) des croix en fer forgé, on recourt à des
schémas s'appuyant sur une vue de dessus du pied ou fût de la
croix sous forme d'une coupe juste au-dessus de la corniche du
piédestal. On y décrit symboliquement plusieurs éléments :
 |
Explications sur le codage : SnCm : n fers structurels
(S) et m consoles (C) ; d pour axes diagonaux et p pour
axes principaux
|
- Croix FF3D avec quatre fers structurels en pied
- Croix FF2D avec deux
fers structurels en pied
- Croix FF1D avec un fer structurel unique en pied